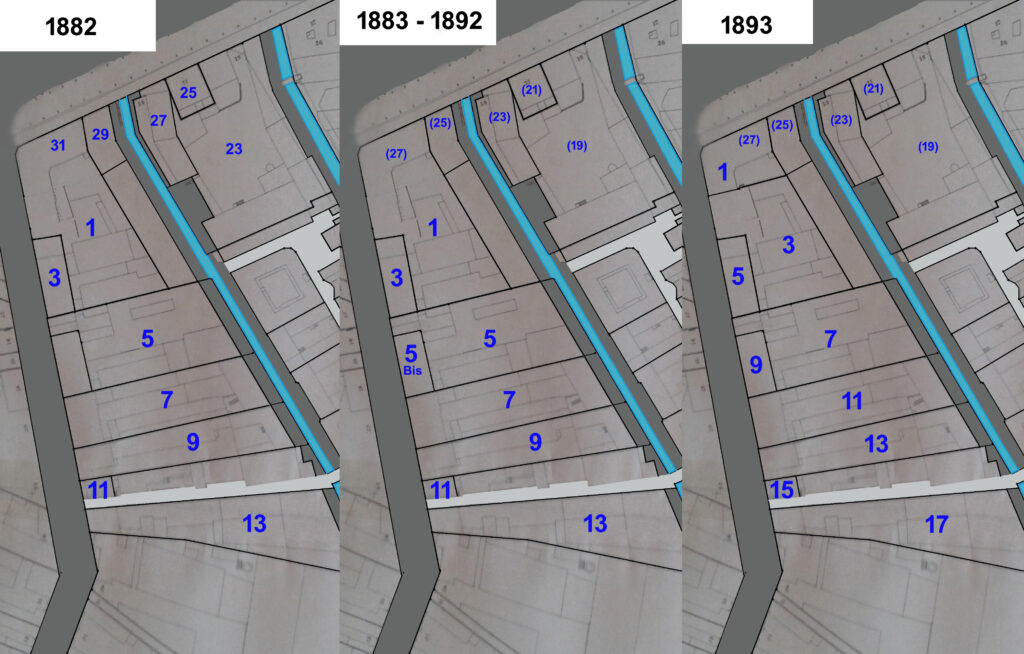Son nom, c’était Crépeau. Mais pour tout le monde, c’était Le Crapaud.
Tout le Monde. Lire : toute la classe. Si au moins il n’avait eu que le seul malheur ordinaire d’arriver de nulle part dès la rentrée, parmi d’autres «nouveaux», son intégration au groupe — presque les mêmes têtes depuis quatre ans — aurait peut-être pu se réaliser. Mais débarquer là en plein mois de janvier, c’était le pavé dans la mare étale des rôles établis.
Les rôles.
Tout en haut de la hiérarchie, les deux chefs d’équipe au ballon-chasseur, Dubuc et Delisle. Le premier, flamboyant, direct, puissant. L’autre, sournois, effacé, efficace. L’offensif et le défensif. «Beu» tuait tout — excepté Delisle, l’immortel. Depuis la Première Année, ces deux capitaines étaient suivis des mêmes guerriers, yin ou yang à leur ressemblance. Puis il y avait les lieutenants idoines, Girard et Morin.
Ensuite venait le fou de la classe, Parent, impayable. Les cancres, Demers, Gauthier, Davignon, égayaient l’atmosphère à toujours récolter des zéros — sauf en dictée, naturellement : Monsieur zéro-faute, c’était moi. Guérin, inamovible premier de classe, commandait le respect par sa paradoxale modestie.
Mais le poste le plus critique, c’était celui de mouton noir, assuré par Belhumeur — un ancien «nouveau» — jusqu’à l’arrivée du Crapaud.
Le mouton noir assume une fonction essentielle à la cohésion d’un groupe. C’est le rassembleur, le point de fuite qui permet à l’ensemble de se définir en fonction de la distance de chacun par rapport à lui, l’ostracisé. Il est la caution universelle, le «pire encore» que tout accusé peut invoquer à sa décharge.
Lorsque l’animosité du ballon-chasseur passe un certain seuil, le jeu dégénère en une chaotique éruption de «ballon-massacre» : il n’y a plus de carré, plus de lignes, plus de limites. On court partout, les équipes sont abolies. Celui qui s’empare du ballon le tire dans la face de son choix, on ne compte pas les points. Chaotique ? Pas longtemps. Après quelques moments, cette violence pure se focalise fatalement sur le mouton noir, receveur universel, réceptacle attitré de tous les épanchements. Littéralement lapidé, il ne sera sauvé que par la cloche annonçant la fin de la récréation.
Après la curée, tous sont frères en rentrant, Dubuquois comme Delinsuliens. Même l’ostracisé est rayonnant : il perçoit confusément le service qu’il vient de rendre, et il subodore en nous quelque vague reconnaissance à son égard. Le seul genre de gratification à laquelle il peut espérer avoir accès.
Tout groupe, adultes autant qu’enfants, et surtout adolescents, tend donc naturellement à se doter de l’indispensable mouton noir. Une autre des fonctions de ce précieux animal, et pas la moindre, consiste, par sa présence même, à garantir à chaque autre individu de ne pas se voir imposer le rôle. Car il en faudra toujours un. Par conséquent, ce sont précisément ceux qui seraient le mieux qualifiés pour prendre sa place, qui en feront le plus pour l’y maintenir. La recette en est simple : plus on stigmatise le mouton noir, plus il est consacré. Et vice-versa.
Beautés de la nature humaine.
Ainsi, Belhumeur n’était pas le moins acharné sur le dos du Crapaud. D’être passé par là ne l’inclinait aucunement à l’empathie pour son successeur. Au contraire, pour lui, il était primordial de ne plus y retomber, ce qui lui interdisait toute faiblesse envers Crépeau. Les requins ne portent pas secours à un congénère blessé, ils se jettent dessus.
Vint la fin de l’année. L’été qui disperse les écoliers. Puis, trop vite, la rentrée. On avait oublié tout ça.
Vraiment ?
Qui sera de retour en cinquième ? Au rassemblement dans la cour, on avait pu constater que la classe était à peu près intacte. Les principaux acteurs étaient tous là, prêts à reprendre où ils avaient laissé. Le Crapaud aussi. Résigné, il ne songeait même pas à contrecarrer l’implacable dynamique qui l’immolait sur l’autel de la petitesse.
Même la maîtresse cédait à l’ostracisme. Après seulement deux semaines, elle avait fait placer le pupitre de Crépeau en retrait des autres, près du tableau. J’avais beau me demander ce qu’il avait bien pu faire pour mériter ça : rien de particulier, rien que n’importe quel autre n’avait pas fait. Voulait-elle le soustraire à l’hostilité poisseuse qui régnait dans sa classe ?
Faut dire qu’il ne s’aidait pas beaucoup, non plus. Maladroit, distrait, incongru, parfois cocasse de gaucherie, mal habillé, pas trop propre, il n’avait vraiment pas le don de passer inaperçu, talent qui lui aurait été bien utile… Au lieu de ça, chacun de ses faux pas était remarqué, noté, exploité.
Une bénédiction, le maudit Crapaud ! On pouvait le dénigrer, le ridiculiser, le calomnier, le faire marcher pour aussitôt le trahir ignoblement, un par un, à plusieurs ou toute la classe ensemble, jamais de réprimande de la part de l’autorité. D’expérience, les enseignants étaient habitués à pareil spectacle, selon eux inévitable, donc normal. Voire : utile. Agent de cohésion davantage que de perturbation, parfait exutoire des inextinguibles agressivités juvéniles, le mouton noir rendait possible le déroulement de l’année scolaire sans éclatement. La dislocation était pour lui seul. D’un point de vue statistique, un excellent rapport coût-bénéfice, somme toute. Dommage collatéral acceptable.
Ainsi se passa la cinquième année. Vint ensuite la sixième, escortée par l’approche de la puberté chez plusieurs. Rien pour calmer le jeu.
Tout le monde était là. Le Crapaud allait reprendre du service.
Mais — était-ce hormonal ? — les dérapages ont tout de suite revêtu un caractère beaucoup plus agressif. Le mince vernis d’innocence qui, encore l’année d’avant, couvrait les actes de la horde, était désormais complètement décapé. Aussi, tout était plus affirmé. Fini les furtifs coups de coude sortis de derrière une porte de case, ou de vandaliser ses effets scolaires, prétendre ne pas avoir fait exprès de l’éclabousser. Enfantillages dépassés. Dorénavant, ça tapait dur, et direct.
Quant à lui, transfiguré par un été de délinquance (il a lui-même raconté qu’il était allé jusqu’à déféquer dans un confessionnal, ce qui, vantardise ou vérité, était pareillement choquant) ; Le Crapaud, donc, s’était mis à répliquer aux coups. Pour comble, plus de maîtresse : un prof, maintenant. Adieu l’atténuant cocon d’une présence féminine, bonjour la virilité sans partage. L’année allait être longue.
Je me souviens d’une scène surréaliste, dès septembre.
Un midi, hourvari dans la grande salle, sitôt franchie la porte de la classe. Ne sachant ce qui se passe, je me renseigne. Bérubé, au comble de l’indignation, m’explique que Le Crapaud a frappé Girard. Infamie ! Oubliant de songer que Girard est réputé, depuis toujours, pour être plus que capable de se défendre — son frère fait du karaté — je sombre à mon tour dans les affres du lynchage. Du coin de l’œil, j’aperçois le gredin, subrepticement dégagé de la cohue, qui se faufile vers la sortie en rasant les murs.
«Y’est là !!!»
La ruée. Ce n’est plus seulement l’habituelle poignée de séides qui part en chasse, mais presque toute la classe, vingt dogues ivres de rage virale qui s’élancent dehors aux trousses de la bête. Je cours avec les autres. C’est à peine si je m’entends me demander s’il m’a déjà fait quelque chose, lui. Solidarité !
Éperdu, Le Crapaud fuit, se retournant de temps en temps pour constater que la distance diminue entre lui et cette haine vociférante qui le pourchasse depuis toujours. Son épouvante devient palpable. J’en vois qui se pourlèchent, d’autres qui se tâtent. L’école est déjà loin, oubliée, ne demeure qu’un quartier indifférent dans les rues duquel un enfant traqué cherche vainement le salut. L’hallali est imminent.
Haletante, notre proie gravit un court escalier, aussitôt assiégé. Désormais cerné, Le Crapaud roule des regards exorbités vers cette meute aboyante qui, tous crocs découverts, semble vouloir le déchirer. Un naufragé sur un récif à marée montante n’est pas plus en perdition.
Le paria frappe fébrilement à la porte de ces étrangers où il espère trouver refuge. Peu soucieux d’une confrontation avec quelque adulte, personne d’entre nous ne monte le chercher. Il cogne encore, mais la maison demeure désespérément sourde. On s’enhardit.
Dubuc : «Descends, sans ça on te sacre en-bas.»
Accablé, Le Crapaud descend l’échelle vers le gibet. Alors, s’improvise un tribunal. Au centre du cercle hostile, l’accusé fait face à sa victime, Girard, et à Dubuc, solennel. Le procès est expéditif.
– Tu l’as frappé ?
Hochement de tête.
– Là, c’est à son tour.
Beu s’écarte, laissant la place à son lieutenant, qui n’était pas préparé à ça. Une clameur s’enfle, la foule vient d’être prise par le goût du sang. Je commence à décrocher, bientôt nauséeux. Le bruit couvre ce que dit Girard à Crépeau. Il ne se rue pas dessus. Il n’a pourtant rien à craindre : il est bon batailleur, et si jamais, on est tous là.
Justement, c’est le problème. Se battre dans le feu de l’action, ça va, il connaît ; incarner à froid un bourreau, c’est une tout autre affaire. Bayard n’est pas Sanson. Crépeau baisse la tête, Girard aussi. Les deux sont pris dans l’inexorable engrenage du système. Girard doit s’exécuter. On le sent hésiter, les cris redoublent. Il faut en finir. Il s’avance, l’autre fige, et encaisse trois sonores coups de poing. Un filet de sang lui coule d’une narine. C’est fini.
Rassasiés, on part dîner.
Oui, l’année a été longue. Et la septième donc ! Mais Le Crapaud a survécu.
LUI, oui. Un quart de siècle plus tard, il a même fait les manchettes : la police venait de l’arrêter après une série de meurtres sadiques, dans le Village gai.